
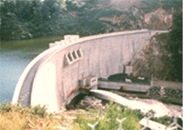
En stockant l’eau, les barrages permettent de régulariser et de sécuriser l’alimentation en eau potable des villes.
L’alimentation en eau potable est une des plus grandes conquêtes auxquelles les barrages aient participé. C’est l’objectif à l’origine, par exemple, du barrage Zola, inauguré à Aix-en-Provence en 1854.
Parmi les réalisations les plus marquantes du XIXe siècle figure également le barrage du Furens à Saint-Étienne, inauguré en 1866. Celui-ci servait tout à la fois à alimenter la ville en eau, à lutter contre les crues et à maintenir l’étiage de la rivière afin de garantir le fonctionnement d’usines hydromécaniques.
De multiples usages
Cette polyvalence des grands barrages est aujourd’hui fréquente. Ainsi, une personne qui se lave les dents à Marseille ignore sans doute que l’eau dont elle se sert a déjà été turbinée une quinzaine de fois pour divers usages !
L’utilisation des barrages pour l’alimentation en eau est d’autant plus nécessaire que les nappes souterraines, surexploitées, ne peuvent plus subvenir à elles seules aux besoins. Les eaux stockées dans les retenues permettent ainsi de s’adapter aux variations du cycle hydrologique.
Cet usage peut aussi être industriel, soit directement comme dans l’industrie chimique ou le raffinage, soit indirectement comme pour le refroidissement des centrales électriques. L’eau stockée peut même servir à diluer les rejets polluants, afin de maintenir les cours d’eau à un niveau de qualité acceptable.
Pour en savoir plus
- Eau_potable_(version_longue) (format pdf – 54.6 ko – 02/01/2008)