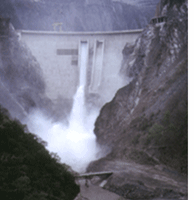

La gestion de l’évacuation des crues peut avoir des conséquences sur le choix du type de barrage, selon les conditions hydrologiques et topographiques du site concerné.
En effet, un barrage en terre peut plus difficilement intégrer un évacuateur de crue, notamment dans le cas des ouvrages les plus grands. Dans un tel cas, les concepteurs pourront être amenés à préférer un barrage en béton.
En outre, un barrage en terre s’avère plus sensible à la submersion en cours de travaux qu’un barrage en béton.
L’évacuation des crues comporte en effet deux aspects :
![]() pendant la construction du barrage ;
pendant la construction du barrage ;
![]() une fois celui-ci achevé.
une fois celui-ci achevé.
Au cours du chantier, celui-ci va être protégé contre une crue d’une fréquence donnée, au minimum dix ans – souvent plus en fonction de sa durée.
Le risque sera calculé de telle façon que les conséquences économiques soient supportables et qu’il ne puisse se produire de pertes humaines.
Certains ouvrages de dérivation construits alors, notamment des tunnels, seront réutilisés ultérieurement dans le fonctionnement du barrage lui-même, par exemple comme vidange de fond définitive ou comme évacuateur de crues.
Une fois le barrage en service, il existe plusieurs solutions pour évacuer les crues. Mais la hauteur croissante des ouvrages et l’énergie à dissiper lors de celles-ci amènent généralement les concepteurs à opter pour la réponse suivante : un seuil, commandé ou non par des vannes, suivi par un coursier en saut à ski pour dissiper l’énergie, avec, éventuellement, à son extrémité un bassin de dissipation.