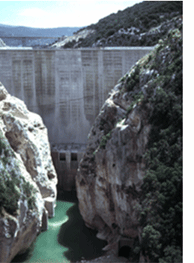
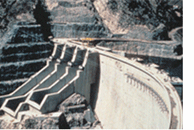
L’hydroélectricité est une source d’énergie essentielle, propre et renouvelable. Son exploitation permet de réduire l’appel à d’autres sources plus polluantes ou non renouvelables.
Bien avant l’essor de l’électricité, l’eau fut utilisée pour produire de l’énergie hydromécanique, grâce aux moulins.
Puis, au XVe-XVIe siècles, elle sert à alimenter les hauts-fourneaux de l’industrie métallurgique alors en plein essor. Des barrages sont construits ou surélevés pour alimenter les « lacs des forges » qui se répandent bientôt dans tout le pays.
En 1860, l’énergie hydraulique apporte ainsi 75 % de la puissance fixe des machines installées dans les usines, contre 25 % à la vapeur !
L’essor de l’hydroélectricité
En revanche, la prise de conscience de la nécessité d’équipements hydroélectriques n’intervient que tardivement. La loi sur l’eau de 1919 marque un tournant en imposant une véritable nationalisation des ressources hydrauliques.
Parallèlement, un vaste programme de construction de barrages est lancé. Ralenti par la crise des années 30, il ne décollera vraiment qu’après 1946.
Un « appoint » qui reste essentiel
Aujourd’hui, les principales régions équipées sont le Rhône, la Durance, les Alpes, les Pyrénées et le Massif Central (dont la Dordogne). En 1960, l’hydroélectricité fournissait 60 % de l’énergie consommée en France. Ce chiffre est depuis retombé entre 12 et 15 %, suite au développement du nucléaire.
L’hydroélectricité n’en reste pas moins une ressource essentielle : il s’agit en effet d’une énergie de pointe, mobilisable en quelques minutes seulement, contrairement à celle fournie par les autres types de centrales.
Son autre grand atout, c’est la possibilité de stocker l’énergie fournie par les barrages intégrant une station de pompage, comme celui de Grandmaison.
En savoir plus
- Énergie_(version_longue) (format pdf – 65.4 ko – 02/01/2008)