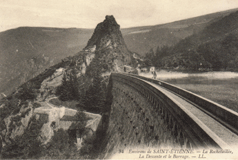
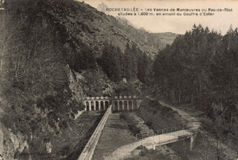
Entre 1801 et 1866, la population de Saint-Étienne avait été multipliée par six, passant de 16 300 à 96 600 habitants : cela en faisait la huitième ville française. Conséquence de la révolution industrielle, cette urbanisation réclamait des équipements en conséquence.
Il fut donc décidé de bâtir un barrage sur le Furens, rivière qui traversait la ville de part en part. Avec un objectif multiple : protéger la ville contre les crues, assurer l’alimentation en eau de la cité, relever le débit d’étiage pour le fonctionnement des usines encore hydromécaniques.
L’ouvrage, réalisé en maçonnerie, marque une étape décisive dans la rationalisation des approches de la conception et de la construction. Avec 56 mètres de haut, il devient le plus haut barrage du monde encore en service, détrônant Tibi en Espagne, qui avait occupé ce rang pendant plus de trois siècles.
Inauguré en 1866, il fait école dans le monde entier pour le calcul des barrages-poids. Les ingénieurs à l’origine de sa conception n’avaient pourtant pas cherché à établir un nouveau record, juste à répondre au défi lancé par la municipalité de Saint-Étienne. C’était le site qui, simplement, ne leur laissait pas d’autre choix.