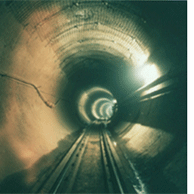
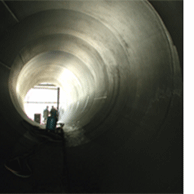
Les tunnels creusés pour la réalisation de barrages constituent l’un des réseaux de souterrains les plus importants du pays : 1 500 km au total en France.
Nécessaires notamment à la mise hors d’eau du chantier, il peut s’agir de tunnels de très grand diamètre, plus de 10 mètres pour certains. Les premiers ont été percés à la fin du XIXe siècle, dans les Alpes notamment, bénéficiant des progrès en matière d’air comprimé et d’explosifs.
Pour certains ouvrages, le bassin versant peut s’avérer insuffisant pour remplir la cuvette hors des périodes de crues saisonnières, à la fonte des neiges. On va alors dériver des torrents voisins, comme à Roselend où la longueur totale des galeries atteint 100 km !
C’est dans le cadre de chantiers de ce type qu’a été développée la technique des tunneliers, notamment sur la dérivation Isère-Arc.
Les tunnels de dérivation à grand diamètre doivent supporter une pression considérable de l’eau, ce qui suppose une grande qualité de construction et amène aujourd’hui à les fabriquer en béton.
L’autre type de tunnels construits dans le cadre des barrages est ceux qui permettent d’alimenter, notamment en montagne, les usines situées 500 ou 1000 m plus bas que la retenue. Ces ouvrages extrêmement importants ont demandé une grande connaissance des massifs rocheux, contribuant au développement de la mécanique des roches.
Pour en savoir plus
- Tunnels_(version_longue) (format pdf – 53.9 ko – 02/01/2008)